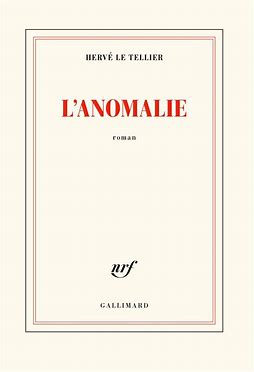« Dieu est mort ! » a pu-t-on lire ces derniers jours dans la presse internationale, en un unanime élan journalistique censé rendre hommage à Diego Armando Maradona, « le plus grand footballeur de tous les temps ».
Ils sont marrants tout de même, ces journalistes sportifs. Qui s’entichent de la prose de Nietzsche pour célébrer leur Dieu et déplorer sa disparition. Un petit rappel toutefois à leur intention : loin de verser des larmes, le philosophe allemand, par la voix de son Zarathoustra, clamait bien au contraire son bonheur devant une telle nouvelle. Car si Dieu est mort, disait-il, les hommes désormais sont libres. Friedrich Nietzsche n’avait ainsi d’autres projet que de débarrasser ses contemporains de Celui qu’ils avaient eux-mêmes créé et devant Lequel ils soumettaient leur existence. Mais alors, et c’est là où je souhaiterais en venir, combien est-il surprenant de constater que le cri de joie nietzschéen s’est transformé aujourd’hui, au point d’exprimer le contraire, de pleurer Dieu, un autre Dieu, un Dieu du football, que la presse elle-même, dans la société qui est la sienne, a fabriqué. A fabriqué lentement, patiemment. Jusqu’à, c’est mon point de vue, le mettre à mort.
Maradona n’est pas seulement le meilleur joueur de foot que ma jeunesse a pu admirer. Il est aussi celui par lequel le football, à l’image de la société dans laquelle il évoluait, s’est transformé. De divertissement populaire, le foot est devenu, à partir des années 80, une gigantesque industrie, une « religion » (encore un terme pieu), une machine à fric. Avec toutes les déplorables conséquences dont les media dans leur globalité nous entretiennent sans cesse, sans jamais ou presque y porter un regard critique : starification absurde des joueurs ou des entraîneurs, inflation démesurée des prix des transferts et des salaires, théâtralisation des compétitions, sacralisation de l’identité des clubs dans un climat de guerre permanent, glorification d’un sport devenu opium du peuple, j’en passe et des plus insensées, entraînant une sorte d’idolâtrie tout droit dirigée vers un paradis le plus souvent inaccessible. Un paradis promis à un gamin surdoué issu des bidonvilles de Buenos Aires qui, lentement mais sûrement, deviendra un enfer.
Diego, tout au fond de son trou sans eau courante ni électricité, n’était pas prêt à affronter tout ça (l’argent facile, la gloire, les patrons véreux, la mafia, la drogue, les journalistes, …) Moitié ange, moitié démon (toujours en termes pieux) s’interroge la presse ? Coupable de sa déchéance ? Il faudrait plutôt s’interroger sur les véritables raisons de celle-ci.
Alors non, ce n’est pas Dieu qui est mort. C’est le petit Diego. Ce petit garçon photographié avec un ballon devant son taudis. Ce joueur sans égal qui un soir de Coupe d’Europe, pendant l’échauffement, devant des caméras admiratives, retrouvait pour un instant d’éternité le plaisir le plus pur, le bonheur de jouer.