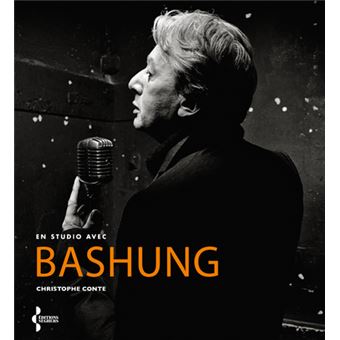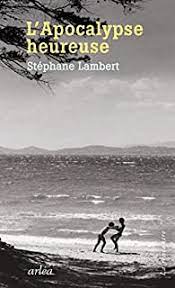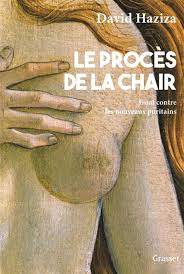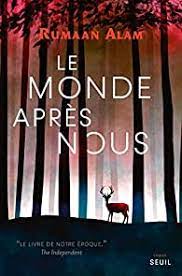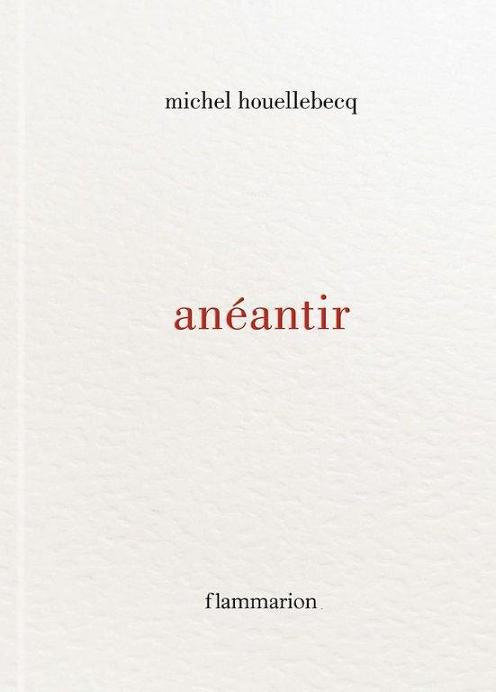J’ai vu Bashung sur scène à deux reprises, au début et à la fin. La première fois, c’était dans mon patelin, au Théâtre communal de La Louvière. On était au milieu des années 80. Un copain, fan de rock et de punk, grand habitué des salles de concert, toujours au faîte de la moindre actualité musicale « digne de ce nom », m’y avait emmené. Le nom de Bashung ne m’était bien sûr pas étranger mais, à vrai dire, je ne le connaissais que très peu, n’ayant jamais acheté un seul de ses disques. En fait, ce concert constituait une véritable expérience pour moi qui, une fois n’était pas coutume, sortais des sentiers battus de la culture pop & rock plébiscitée à la radio ou à la télévision.
Alain Bashung n’en était pourtant plus à ses balbutiements. Après dix ans de galère et de compromis frustrants jusqu’à la résignation, il était sorti de l’anonymat avec deux énormes tubes, Gaby oh Gaby et Vertige de l’amour. Pour ensuite casser ces précieux cadeaux – détruire l’acquis pour s’en aller là où on ne l’attend pas, « oser l’imprudence », sera toujours une constante chez lui – et enchaîner des albums très personnels, totalement en marge, complètement casse-gueule qui se révélèrent presqu’à chaque fois autant de bides commerciaux. Et même si la critique autorisée encensait le plus souvent la singularité des textes de ses chansons alliée à une démarche authentiquement rock dans un paysage musical français très peu habitué à ça, Bashung continuait de marcher sur une ligne blanche, entre gouffre financier et vertiges alcoolisés, qui pouvait le voir disparaître du jour au lendemain.
La deuxième fois que je l’ai vu sur scène, à l’AB de Bruxelles, c’était peu avant qu’il meure d’un cancer du poumon. A la fin d’une trajectoire qui l’avait vu patiemment, progressivement, rigoureusement déployer une envergure qu’aucun de ses contemporains de la scène musicale française n’avait atteint. Aucun.
Comment en était-il arrivé là ? Comment moi j’avais vécu cette métamorphose ? En 86, j’avais fait la découverte d’un iconoclaste brandissant son rock non consensuel et ses calembours à la pelle, des jeux de mots souvent obscurs et parfois lourdingues, avec une singularité qui autorisait ma timide jeunesse à croire que j’étais dans le coup. Mon conformisme post-adolescent se devait d’aimer ce concert à la marge (ce qui ne fut pas vraiment le cas en réalité) pour que mon manque d’assurance de l’époque puisse s’affirmer sur la page des autres. En 2008, plus rien à voir : j’allais communier avec celui qui était devenu le plus grand chanteur français de sa génération et l’une de mes idoles.
Mais quelle putain de trajectoire que celle de Bashung ! D’année en année, d’album en album, Alain Bashung s’est acharné dans le domaine qui était le sien à se rapprocher de ce qu’il était vraiment, à aller jusqu’au bout de lui-même. Comme si sa vie se devait d’incarner le mot de Nietzsche : « Deviens qui tu es ! « . De jeune rebelle post-punk à la langue bien pendue (période Boris Bergman, parolier en chef, géniteur de trouvailles textuelles à la sulfateuse qui toutes, il faut bien l’avouer, n’ont pas atteint leur cible), Bashung s’est peu à peu mué en phénix renaissant sans cesse des cendres dans lesquelles on voulait l’immortaliser. Toujours ailleurs, toujours plus exigeant, toujours en recherche, obsédé par l’idée de ne jamais refaire ce qu’il avait déjà fait. Jusqu’à devenir une sorte de maître d’une musique des sphères. Un metteur-en-scène d’une production aux multiples collaborations et aux influences les plus diverses. Un porte-voix (et quelle voix !) d’une langue sublime, poétique dans la plus pure acceptation du terme (période Jean Fauque, bénie soit-elle). Une langue qui, au-delà d’un sens directement accessible, malaxée jusqu’à l’éclatement de la beauté, s’est ingéniée à agencer des mots d’où surgissent des sentiments, des interprétations multiples et toujours renouvelées, des émotions inscrites dans le marbre de nos mémoires.
En studio avec Bashung, le très beau livre que lui consacre Christophe Conte, revient sur ce parcours exceptionnel. Soulignant tout l’acharnement de cet homme, à travers ses albums successifs, à « devenir ce qu’il est ». N’épargnant aucun de ses excès, aucune de ses obsessions à se détruire, aucune de ses indécisions, de ses fulgurances, de ses sautes d’humeur, parfois même aucune de ses petites lâchetés. Traçant le portrait d’un artiste qui aura, à l’image d’un grand cinéaste, réussi à digérer la contribution de multiples collaborateurs pour construire une œuvre la plus personnelle qui soit. Et qui, un soir d’hiver à l’AB, chancelant sous des derniers assauts métastasés, me permit de vivre l’un des plus émouvants moments de ma vie.