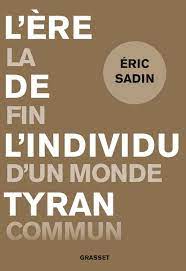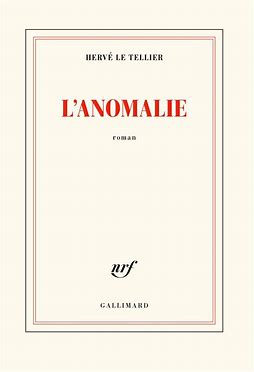Toute ma vie, je me suis trompé. Je me suis trompé sur presque tout. Sur Dieu, sur le monde idéal, sur l’amour, sur la liberté…
Je me suis trompé sur la liberté. Né au milieu des années 60, devenu adolescent à la fin des années 70, j’ai poussé dans le grand vent des libertés que ces deux décennies entendaient conquérir. A l’époque, il fallait à tout prix tuer le père, abattre le Capital, consacrer la mort de Dieu, mettre à pied la morale conservatrice, arracher le corset d’une société qui manquait d’air. A tort ? Mais non bien sûr, à raison ! Loin de moi l’intention de faire a posteriori le procès uniquement à charge que d’aucuns font désormais de cette époque enthousiasmante, de tous ces « Mai 68 » (de Paris à San Francisco ou de Prague à Berlin) qui ont permis aux bienheureux qui l’ont vécu et/ou qui en ont bénéficié de vivre leur liberté comme jamais personne n’avait pu l’envisager auparavant.
Il n’empêche. Force est d’admettre qu’on ne peut aujourd’hui, à défaut de procès, en éviter la critique, taire tous les excès de cette époque « bénie », ses aveuglements, ses délires. Et ils sont nombreux. Dans tous les domaines. Du soutient soutenu voire inconditionnel aux révolutions, dictatures ou terrorismes étiquetés « communistes » (la Chine de Mao, le Cuba de Castro, le Cambodge de Pol Pot, les assassinats de la Rote Armee Fraktion en Allemagne, d’Action Directe en France, des Brigades Rouges en Italie, …), jusqu’aux errements les plus incompréhensibles en matière de mœurs (dont l’abominable sommet aura sans doute été atteint en 1977 lorsque la crème de l’intelligentsia française, Sartre en tête, signa une lettre ouverte réclamant la décriminalisation de la pédophilie).
Le siècle vivait sa post-adolescence, obsédé par l’idée d’égalité, parfois jusqu’au mépris de la vie humaine. Et réclamait sa pleine jouissance, guidée par la seule exigence du plaisir , jusqu’à l’instrumentalisation des plus fragiles. Du délire, en effet.
Comment en était-on arrivé là ? C’est pas moi qui le dit, ce sont des gens bien plus éclairés que moi : ces excès ont été commis par une conception par trop idéologique de l’égalité et de la liberté. Laquelle, toute puissante, engageait certains des plus brillants leaders d’opinion de la planète à tirer des conclusions de leurs a priori au déni de la réalité. Bref, à ne pas vouloir voir ce qui se devait d’être vu et condamné. Comme bien d’autres, cette conception d’une liberté sacralisée m’a longtemps influencé. Plus aujourd’hui. Et s’il y a une chose que les diverses crises que nous traversons (climatique, terroriste, pandémique) m’ont définitivement appris, c’est que, étrangère à toute idéologie, la réalité a repris le dessus.
De liberté, « en réalité », il n’y a d’autre que celle que notre environnement entend nous laisser. Notre environnement familial, social, historique, politique, écologique, cosmologique nous façonne et ne nous laisse finalement qu’une très étroite marge de manœuvre. Dans une démocratie, cette marge est évidemment plus large qu’en dictature. Mais elle demeure très relative. Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, nous nous sommes habitués à croire que cette liberté nous était définitivement acquise. La démocratie, le progrès social, les trente années glorieuses qui ont succédé nous ont progressivement installé dans une confortable bulle de verre dont nous avons oublié jusqu’à l’existence. Les crises économique et démocratique l’ont effritée; les conjectures climatiques, le surgissement terroriste et plus encore la contamination pandémique l’ont fait éclaté. Et de liberté ne demeure que notre capacité à nous adapter à ce qui nous est imposé. Spinoza avait raison : il nous faut être conscient de ce qui nous détermine pour pouvoir agir librement.
La vie elle-même nous étant contrainte, la naissance ne constituant (pour reprendre un bon mot glané dans mes lectures) qu’une condamnation à mort, pourquoi nous étonnerions-nous que notre liberté ne puisse s’affranchir des contingences du monde extérieur ? De ce qui la dépasse. Des structures microscopiques de notre appareil neurologique aux équilibres instables du cosmos.
Je manquais d’humilité quand j’étais jeune. Mon nombril s’imaginait coupé de la marche du monde, du destin de l’univers. Dont le silence inouï n’a jamais cru nécessaire de commenter mes précieuses et prétendues libertés.