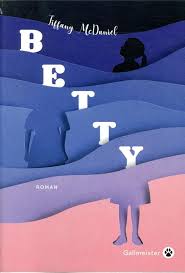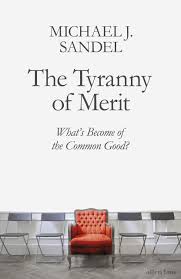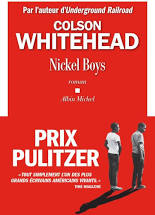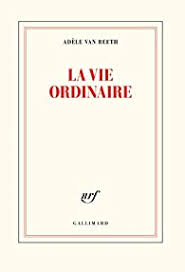Toute ma vie, je me suis trompé. Je me suis trompé sur presque tout. Sur Dieu, sur le monde idéal, sur l’amour, sur la liberté…
Je me suis trompé sur le monde idéal. J’ai pensé longtemps qu’il était envisageable. Quand j’étais enfant, j’étais habité par une sorte de fantasme récurrent : je nourrissais l’espoir qu’un jour les gens autour de moi seraient débarrassés de toutes barrières, qu’ils vivraient nus (dans tous les sens du terme) dans la plus profonde vérité d’eux-mêmes, ne dissimulant aux autres rien de ce qu’ils étaient réellement. Je pensais qu’on pourrait vivre comme ça, comme dans des maisons de verre et que cette « vérité perpétuelle et intégrale » offerte à chacun permettrait à tous de mieux vivre ensemble. Mon désir d’absolu, bien compréhensible à l’âge qui était le mien, ressemblait au fond à la promesse des amants qui jurent de ne jamais rien se cacher. Ou au paradis qu’on m’avait enseigné.
Ce besoin d’absolu ne m’a pas quitté de sitôt. Mais il s’est transformé, a trouvé une traduction politique. Au moment de l’adolescence déjà, et puis surtout quand j’en suis sorti, j’ai continué à nourrir l’espoir d’un monde idéal, d’une société parfaite. Une société où le bien commun serait la priorité, où tous se montreraient affables, solidaires, liants et conscients d’appartenir à une communauté dépourvue de castes, de groupes, de différences. Et mes préférences politiques se sont progressivement et naturellement orientées vers une société sans classe, communiste. Ainsi, à vingt ans, mes guides avaient pour nom Marx, Lénine ou Trotski. A l’époque, au milieu des années 80, il était encore possible de voir en eux les plus brillants inspirateurs d’une justice sociale bafouée dans nos sociétés capitalistes, étrangers à toutes les dérives et autres trahisons que leur idéal s’était vu subir en Union Soviétique ou en République Populaire de Chine. Avec le temps, il m’a fallu toutefois admettre que ce paradis sans classe ne pouvait être qu’imposé et se révéler ici-bas un enfer pour tous ceux qui, comme moi, rêvaient enfant de vivre pleinement, ouvertement et le plus sincèrement possible en toute liberté.
Il y a eu ensuite une longue période de latence. Vingt ou trente années pendant lesquelles mes idéaux de jeunesse ont continué à se manifester, à s’accrocher à l’espoir d’un monde meilleur, à véhiculer l’image que je voulais montrer de moi. Et ce en dépit de très nombreux événements, de faits innombrables qui auraient dû me conduire, si je n’avais pas pris l’habitude de les rejeter au fond de ma mauvaise conscience de gauche, à changer mon point de vue. Il y a une phrase de Jean Daniel, fondateur du Nouvel Observateur, qui résume bien mon état d’esprit de l’époque et, je le pense, de celui de beaucoup de ceux qui me ressemblaient : « j’ai toujours préféré avoir tort avec Jean-Paul Sartre plutôt que raison avec Raymond Aron. » Histoire d’y croire encore, sans doute.
Aujourd’hui, bien sûr, je ne pense plus qu’une société idéale soit envisageable. Je pense surtout que ma vision des choses, idéaliste, était biaisée dès le départ. Que croire au paradis sur terre, c’est encore croire au paradis, se mettre en quête d’un arrière-monde, et que cela témoigne avant tout d’une volonté d’ignorer la réalité, d’y échapper. Alors que cette réalité, quoi qu’on puisse imaginer, implique que l’on compose avec elle. C’est ce que nous enseignait le Zarathoustra de Nietzsche : « Contente-toi du monde tel qu’il est ».
Il y a une chose désormais qui me paraît fondamentale, une vérité toute simple à laquelle je reviens sans cesse : notre état de nature, la persistance animale de notre condition humaine, les tensions qui nous habitent depuis toujours entre notre idéal d’élévation et les instincts primitifs qui restent les nôtres. Ces instincts qui font de l’Autre une potentielle menace, un espace à conquérir, et qui nous invitent à nous regrouper, à nous distinguer dans des territoires, derrière des drapeaux, n’envisageant le bien commun qu’en-deçà des limites des communautés que nous avons créées. Toute l’histoire humaine le démontre. Ces tensions, parfois, se relâchent. Puis reprennent de plus belle. Comme aujourd’hui. Loin, très loin d’une société idéale. Loin, très loin des maisons de verre de mon enfance.